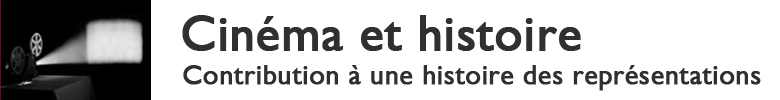L’Ecole des Annales a montré depuis les années 1930 que le document d’histoire pouvait être autre chose que du papier, des documents écrits, et à ce titre le film d’actualités est un document d’histoire comme les autres. La lecture des actualités, envisagées comme n’importe quelle source, doit répondre à une triple exigence critique au carrefour de la critique historique habituelle et de ce qui fait son originalité[1].
La « critique d’identification » est la plus habituelle à l’historien : la recherche de l’origine du document, de l’identification des personnages et des lieux, guident l’interprétation du contenu. L’opération n’est cependant pas toujours évidente et peut se révéler très complexe pour une bande d’actualités dont les montages sont nombreux. Pour des questions de rythme ou d’enchaînements, sont en effet souvent juxtaposés des images de plusieurs sources, époques ou origines différentes.
La « critique d’authenticité » permet d’envisager si le document a été reconstitué, modifié, sciemment ou non. Elle s’appuie sur les indications que l’on peut tirer de l’observation attentive des images elles-mêmes. Marc Ferro dégage plusieurs axes d’attention et de vigilance concernant :
- les angles de prise de vue, qui montrent la continuité ou pas de la prise de vue. Dans une scène de bataille filmée avec une seule caméra, il n’est par exemple pas possible de voir l’action en champ puis en contre-champ, soit les même soldats vus de dos au départ, de face dans l’action. Tout comme peut légitimement étonner la vue d’un canon crachant son obus, immédiatement suivi d’un plan sonorisé qui en montre l’explosion…
- la distance aux différentes images d’un même plan : avant la fin des années 1940/1950, l’impossibilité technique de zoomer rend peu probable le passage d’un plan éloigné à un gros plan ;
- le degré de lisibilité des images et la qualité de l’éclairage renseignent sur les conditions de tournage. Un cadrage parfait, une lumière équilibrée et uniforme de bout en bout d’un sujet monté appellent à la méfiance ;
- le degré d’intensité de l’action dans le cadre d’un document intégral peut aussi susciter quelques réserves.
La « critique analytique » permet de démontrer que, comme un texte ou un discours, une prise de vue est idéologiquement orientée. C’est la « part de non voulu, de non perçu, de non prévu »[2] qui distingue l’image du texte. L’examen porte sur la source émettrice (qui est à l’origine du film ? commanditaire ? commande ? destinataire ?), les conditions de production, de distribution et de diffusion, la fonction du document, sa fréquence éventuelle et sa réception (quel est l’impact auprès du public ? contemporain ? ultérieur ?). Il est complété par l’analyse filmique proprement dite dont l’objectif est de déceler le discours véhiculé par les plans.
Il reste à confronter le film avec les autres sources de l’époque. C’est souvent sur ce principe que se fondent les cours dans l’enseignement secondaire : mettre en relation, confronter l’extrait filmique avec d’autres matériaux de l’histoire, écrits ou iconographiques, afin d’en faire mieux apparaître son originalité ou sa représentativité. Eveiller, stimuler le regard critique…
[1] cf FERRO (Marc), dans Analyse de film, analyse de sociétés, Hachette, Pédagogies de notre temps, 1975, p 18-38 ; Cinéma et Histoire, Gallimard, Folio, 1993, p 109-134 ; et avec PLANCHAIS (Jean), Les médias et l’histoire. Le poids du passé dans le chaos de l’actualité, CFPJ Editions, 1997, p 25-39
[2] FERRO (Marc), dans Analyse de film, analyse de sociétés, op. cit. p 27